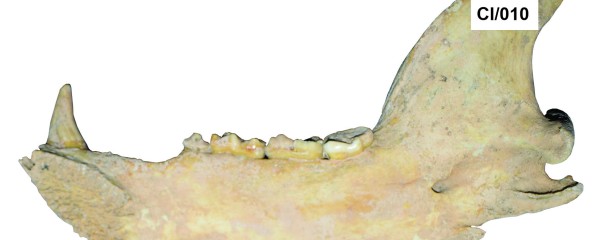Impact de l'astéroïde : émission de soufre moins létale lors de l'extinction des dinosaures

Une équipe internationale de scientifiques a démontré que le rôle du soufre lors de l'extinction massive qui a anéanti les dinosaures non-aviens a été surestimé. Cela suggère un « hiver d’impact » plus modéré qu’on ne le pensait auparavant.
Des études antérieures affirmaient que l'extinction massive qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre avait été causée par l'émission de grandes quantités de soufre provenant des roches du cratère d'impact de Chicxulub. Une nouvelle étude, menée par une équipe internationale dirigée par Katerina Rodiouchkina (UGent et VUB en Belgique, Luleå University of Technology en Suède), remet en question ce scénario. Grâce à des mesures empiriques révolutionnaires de soufre dans la couche limite Crétacé-Paléogène (K-Pg), l'équipe a démontré que le rôle du soufre dans l'extinction avait été surestimé.
Il y a environ 66 millions d'années, l'astéroïde Chicxulub, dont le diamètre est estimé entre 10 et 15 kilomètres, a frappé la péninsule du Yucatán (dans l'actuel Mexique), créant un cratère de 200 kilomètres de large. Cet impact a déclenché une série d'événements destructeurs, y compris un changement climatique rapide, qui a conduit à l'extinction des dinosaures non aviens et d'environ 75 % des espèces sur Terre. La principale cause de cette extinction serait probablement l'« hiver d'impact », provoqué par une émission massive de poussières, de suie et de soufre dans l'atmosphère. Cet hiver d'impact a entraîné un froid extrême, une obscurité prolongée et un effondrement de la photosynthèse mondiale, avec des effets durables sur les écosystèmes pendant des années, voire des décennies après l'impact.
La plupart des études précédentes considéraient le soufre comme le principal facteur de refroidissement et d'extinction après l'impact. Cependant, les estimations du volume d'aérosols sulfurés libérés par la vaporisation des roches impactées au Mexique variaient considérablement, allant jusqu'à un facteur 100 selon les études. Cette variabilité s'explique par des paramètres incertains, tels que la proportion de roches contenant du soufre sur le site d'impact, la taille, la vitesse et l'angle d'impact de l'astéroïde, ainsi que les pressions de choc exercées sur les minéraux contenant du soufre.

Dans cette nouvelle étude dans Nature Communications, Katerina Rodiouchkina et ses collègues ont utilisé des concentrations de soufre et des compositions isotopiques extraites de nouvelles carottes de forage prélevées dans la région du cratère, ainsi que des profils chimiques détaillés des sédiments de la limite K-Pg du monde entier. Cela a permis aux auteurs d'estimer empiriquement, pour la première fois, la quantité totale de soufre libérée dans l'atmosphère par l'impact de Chicxulub.
Un « hiver d’impact » plus modéré pourrait avoir contribué à la survie d’au moins 25 % des espèces sur Terre après cet événement
« Au lieu de nous concentrer sur l'événement d'impact lui-même, nous nous sommes concentrés sur ses conséquences », explique la chimiste Katerina Rodiouchkina. « Nous avons d'abord analysé l'empreinte sulfurée des roches dans la région du cratère, qui étaient à l'origine des aérosols sulfurés libérés dans l'atmosphère. Ces aérosols se sont dispersés à l'échelle mondiale avant de retomber sur la surface terrestre au cours des mois ou années qui ont suivi l'impact. Le soufre a été déposé autour de la couche limite K-Pg dans les profils sédimentaires du monde entier. Nous avons utilisé le changement correspondant dans la composition isotopique du soufre pour distinguer le soufre lié à l'impact de celui provenant de sources naturelles, et la quantité totale de soufre libérée a été calculée par bilan de masse. »
Les scientifiques ont révélé qu'un total de 67 ± 39 milliards de tonnes de soufre avait été libéré, soit environ cinq fois moins que ce qui avait été précédemment estimé dans les modèles numériques. Cela suggère un « hiver d'impact » plus modéré que ce qui était auparavant supposé, entraînant un refroidissement moins sévère et un rétablissement climatique plus rapide. Cela pourrait avoir contribué à la survie d'au moins 25 % des espèces sur Terre après l'événement.
Bien que le soufre reste probablement le principal moteur du refroidissement global, il est important de noter qu'une étude récente de l'Observatoire Royal de Belgique et de la VUB suggère qu'un énorme panache de fines particules de poussière aurait pu jouer un rôle crucial en créant une période de deux ans de quasi-obscurité, bloquant la photosynthèse et aggravant les impacts environnementaux.
À cette étude ont contribué plusieurs universités et instituts de recherche belges : Universiteit Gent (Ugent), la Vrije Universiteit Brussel (VUB), l’Observatoire royal de Belgique (ROB), l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). Cet article est basé sur le communiqué de presse de l’Université technologique de Luleå en Suède et de la VUB.