ENGIE - Mécénat Scientifique au service de la connaissance des migrations des oiseaux sauvages
La Fondation ENGIE
Créée en 1992, la Fondation d’entreprise ENGIE a pour vocation de traduire en actions de solidarité l’engagement du Groupe ENGIE. Dans le prolongement des réponses métiers aux enjeux sociaux et environnementaux du Groupe, la Fondation soutient des projets philanthropiques innovants qui contribuent à construire un avenir plus harmonieux.
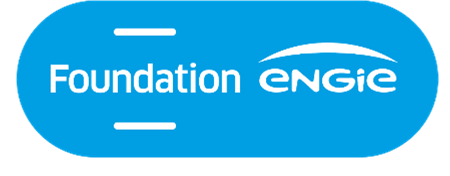

Les Faucons pèlerins font l’objet d’une monitoring spécifique basé sur le baguage des fauconneaux.
La Fondation ENGIE et l’Institut des Sciences naturelles ont conclu un partenariat de mécénat scientifique d’une durée de deux ans.
Le projet soutenu par la Fondation ENGIE agit au cœur de la préservation de la biodiversité. Il consiste en l’écriture et la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion et de partage des données de baguage des oiseaux sauvages, pour remplacer celui existant devenu désuet. L’objectif est de s’appuyer sur les dernières technologies afin d’optimiser le stockage, l’analyse et le partage des données qui parviennent à l’Institut des Sciences naturelles en provenance de toute l’Eurasie et d’Afrique. Annuellement, entre 650.000 et 700.000 oiseaux sauvages sont bagués en Belgique. Le système est parmi les plus dynamiques au monde. Ce nouvel outil permettra aussi de partager les données transmises par balises GPS.
Bagueurs bénévoles, citoyens, chercheurs, décideurs pourront donc encoder, consulter, analyser, découvrir, admirer dans les meilleures conditions les données récoltées depuis 1927 et s’en servir, d’une salle de classe à un conseil des ministres en passant par une thèse de doctorat, afin de contribuer à une meilleure conservation des populations d’oiseaux sauvages. Une réelle contribution à la préservation de la biodiversité !

Philippe Peyrat, Délégué Général de la Fondation ENGIE : “Ce partenariat avec l’Institut des Sciences naturelles fait partie des projets ambitieux pour la préservation de la biodiversité dans lesquels la Fondation ENGIE s’engage au quotidien. Le soutien de la Fondation pour la mise à jour du logiciel de gestion des données de baguage des oiseaux migrateurs reflète notre conviction que chaque action compte pour préserver les écosystèmes et garantir un avenir durable pour notre planète.”
Pourquoi s’intéresser aux migrations ?
Les oiseaux migrateurs nous fascinent depuis toujours. Ils sont parmi les êtres vivants qui ont les plus grandes et les plus rapides capacités de déplacement. Mais leurs périples annuels, qui s’étendent parfois sur plusieurs dizaines de milliers de km à travers la planète, est périlleux !
L’aspect essentiel de la réussite de ces migrations est la présence, tout au cours du trajet, de sites de halte où ils trouveront quiétude et nourriture afin de reconstituer leurs réserves énergétiques en vue … d’arriver sain et sauf à la prochaine étape. En automne le périple les conduira vers les quartiers d’hivernage où la nourriture abonde. Au printemps, il s’agira de revenir au plus vite dans les zones de reproduction afin d’y trouver le meilleur site pour construire son nid et élever une nouvelle génération.
Les oiseaux sont par ailleurs de très bons bio-indicateurs de la qualité de l’environnement. Ils peuvent très utilement nous renseigner sur l’état de conservation d’autres éléments de notre patrimoine naturel : autres animaux, plantes, biotopes.
Identifier les trajets de migration, localiser les sites de halte, observer précisément les éventuelles évolutions de stratégies de déplacements et essayer de les comprendre est essentiel afin de préserver les espèces et les populations. Les zones d’hivernage, les routes de migration ne restent pas figées dans le temps ! Elles évoluent, entre autres suite à la dégradation des milieux naturels et aux changements climatiques. À quel moment partir ? Quelle direction choisir ? Où aller ? Où s’arrêter en route pour reconstituer ses réserves d’énergie ? À quelle date repartir vers les sites de nidification ? Les connaissances doivent être en permanence actualisées, affinées.
Et comme évidemment les migrations ne connaissent pas les frontières, il s’agit de réaliser pareils suivis dans le cadre de collaborations.

La Cigogne blanche est pour beaucoup un emblème parmi les oiseaux migrateurs. Le baguage a permis de découvrir qu’une partie importante de la population européenne ne migre plus jusqu’en Afrique mais passe l’hiver en Espagne. Conséquence des changements climatiques? Non, du fait qu’elles trouvent une source de nourriture quasi illimitée dans les décharges publiques à ciel ouvert...
Bagues et GPS au service d’un indispensable monitoring
Mais comment monitorer, comment étudier ces déplacements au long cours ? Le système, mis en place en 1899 par un instituteur Danois, Ch. Mortensen, consiste à marquer des oiseaux d’une bague en métal inaltérable gravée d’un code alphanumérique unique combiné à une adresse de contact abrégée. Un peu comme un passeport ou la plaque minéralogique d’un véhicule.
Lors du baguage, une série de données biologiques et géographiques sont scrupuleusement notées. Lorsque l’oiseau bagué, et donc individuellement identifié, est retrouvé, au coin de la rue ou à l’autre bout de la planète, ces données sont mises en relation avec celles transmises par la personne qui a découvert l’oiseau bagué. Les données sont soigneusement consignées et, mois après mois, année après année, décennie après décennie, permettent d’atteindre les objectifs poursuivis : faire progresser la connaissance et donc contribuer à la préservation des populations d’oiseaux sauvages.
Ce principe de marquage–découverte n’a pas beaucoup évolué depuis un siècle, mais il s’est développé dans le monde entier. Dans chaque pays ou presque, une institution scientifique de référence organise un système de baguage. En Belgique, il s’agit de l’Institut des Sciences naturelles. En France, c’est le Museum National d’Histoire Naturelle, en Grèce c’est l’Université de la Mer Egée, en Suisse c’est la Station ornithologique de Sempach etc.
La conquête du ciel, par les hommes cette fois, procure cependant de nouvelles possibilités de suivi. De mini balises GPS permettent de suivre en temps réel – ou presque – les déplacements des migrateurs. Technique fabuleuse qui vient en complément du baguage mais ne le remplace pas car les limitations technologiques sont telles que la longévité de ces balises est souvent faible. Tandis que leur poids et le système de fixation sur les oiseaux limite la diversité et le nombre d’individus qui peuvent être ainsi suivis.
Toujours est-il que le système de baguage génère une grande quantité d’informations incroyablement utiles. Mais pour être pleinement utiles, ces données doivent être facilement accessibles. Le logiciel de gestion et de partage des données de baguage des oiseaux mis en place à l’Institut des Sciences naturelles date de … 1990. Il a été entièrement écrit par un collaborateur bénévole et était, à l’époque, tout à fait novateur ! Aujourd’hui, on peut le classer au rayon des dinosaures informatiques. Il est complètement désuet. D’où l’importance de ce partenariat.

Ce Tadorne de Belon a été équipé d’un émetteur qui transmet ses données par GSM dans le cadre d’un programme qui étudie la circulation des virus de la grippe aviaire par les oiseaux sauvages.
Le Phragmite aquatique est le passereau le plus rare et le plus menacé d’Europe. Le baguage a permis de découvrir qu’il traversait la Belgique en migration d’automne, en route vers des zones d’hivernage situées essentiellement dans le delta du fleuve Sénégal.

